Certains livres sont des éclairs dans la poêle, lus pour se divertir puis laissés sur un siège de bus pour que la prochaine personne chanceuse les ramasse et les apprécie, oubliés par la plupart après que leur saison soit passée. D’autres restent dans le coin, sont lus et relus, sont enseignés et discutés. parfois grâce à un grand talent artistique, parfois grâce à la chance, et parfois parce qu’ils parviennent à reconnaître et à capturer un élément de la culture de l’époque.
Sur le moment, on ne peut souvent pas dire quels livres sont quels livres. The Great Gatsby n’était pas un best-seller à sa sortie, mais nous le voyons aujourd’hui comme emblématique d’une certaine sensibilité américaine des années 1920. Bien sûr, le recul peut aussi déformer les sens ; le canon se profile et s’obscurcit. Toujours est-il que, au cours des prochaines semaines, nous publierons une liste par jour, chacune d’entre elles tentant de définir une décennie discrète, en commençant par les années 1900 (comme vous l’avez sans doute deviné maintenant) et en comptant jusqu’à ce que nous arrivions aux années 2010 (presque complètes).
Bien que les livres de ces listes ne doivent pas nécessairement être d’origine américaine, je cherche des livres qui évoquent un aspect de la vie américaine, réelle ou intellectuelle, dans chaque décennie – une lentille globale nécessiterait une liste beaucoup plus longue. Et bien sûr, aussi variée et complexe qu’elle soit, aucune liste ne pourrait véritablement définir la vie américaine sur dix ans ou sur un nombre quelconque d’années, aussi je ne prétends pas être exhaustif. J’ai simplement sélectionné des livres qui, s’ils étaient lus ensemble, donneraient une image fidèle du paysage de la culture littéraire de cette décennie, à la fois telle qu’elle était et telle qu’on se la rappelle. Enfin, deux remarques sur le processus : Je me suis limité à un livre par auteur sur l’ensemble de la liste en 12 parties, donc vous pouvez voir certaines œuvres sautées en faveur d’autres, même si les deux sont importantes (par exemple, j’ai ignoré Dubliners dans les années 1910 pour pouvoir inclure Ulysse dans les années 1920), et dans le cas d’œuvres traduites, j’utiliserai la date de la traduction anglaise, pour des raisons évidentes.
Pour notre huitième épisode, vous trouverez ci-dessous 10 livres qui ont défini les années 1970. (Dirigez-vous ici pour les années 1910, les années 20, les années 30, les années 40, les années 50 et les années 60).
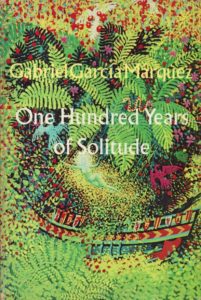 Gabriel García Márquez, Cent Ans de Solitude (première traduction anglaise, 1970)
Gabriel García Márquez, Cent Ans de Solitude (première traduction anglaise, 1970)
Bien que l’opus magnum de García Márquez ait été publié en Argentine en 1967, et ait contribué à inaugurer le boom littéraire international latino-américain, il n’a pas été publié en anglais avant 1970. Le succès a été immédiat. « Le roman est sorti de presse à Buenos Aires le 30 mai 1967, deux jours avant la sortie du Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band, et la réaction des lecteurs hispanophones a été comparable à la Beatlemania : foules, caméras, points d’exclamation, sentiment qu’une nouvelle ère commençait », a écrit Paul Elie dans Vanity Fair. Le livre s’est vendu à 8 000 exemplaires en Argentine dès la première semaine. Après sa publication en anglais, l’édition de poche « est devenue un totem de la décennie ». Au moment où García Márquez a reçu le prix Nobel, en 1982, le roman était considéré comme le Don Quichotte du Sud global, la preuve des prouesses littéraires latino-américaines, et l’auteur était « Gabo », connu sur tout le continent sous un seul nom, comme son ami cubain Fidel. »
Il n’a pas seulement été lu mais acclamé de presque tous les coins. William Kennedy l’a décrit de la façon suivante dans le New York Times Book Review : « Cent ans de solitude est la première œuvre littéraire depuis le livre de la Genèse qui devrait être une lecture obligatoire pour toute la race humaine. . . . M. García Márquez n’a rien fait de moins que de créer chez le lecteur un sentiment de tout ce qui est profond, significatif et sans signification dans la vie. » Il a remporté des prix littéraires en Italie, en France, au Venezuela et aux États-Unis. Il a influencé d’innombrables romanciers, de Toni Morrison à John Irving en passant par Salman Rushdie. Il continue d’être lu, étudié et adoré, a été traduit dans plus de 37 langues et vendu à plus de 45 millions d’exemplaires. C’était le premier roman préféré de beaucoup de gens. C’est encore le roman préféré de beaucoup de gens.
En 2009, le magazine littéraire international Wasafiri a demandé à 25 écrivains du monde entier de » choisir le titre qui, selon eux, avait le plus influencé l’écriture mondiale au cours du dernier quart de siècle « , et seul Cent ans de solitude a reçu plus d’un vote (trois, pour être exact). » a appris à l’Occident à lire une réalité différente de la sienne, ce qui a ouvert les portes à d’autres écrivains non occidentaux comme moi-même et d’autres écrivains d’Afrique et d’Asie « , explique l’écrivain ghanéen Nii Ayikwei Parkes. « En dehors du fait que c’est un livre incroyable, il a appris aux lecteurs occidentaux la tolérance pour d’autres perspectives. »
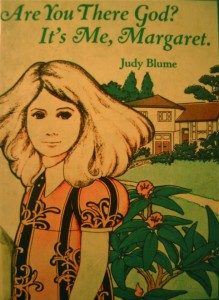 Judy Blume, Es-tu là Dieu ? C’est moi, Margaret (1970)
Judy Blume, Es-tu là Dieu ? C’est moi, Margaret (1970)
« On pouvait presque entendre le soupir collectif de soulagement des générations en 1970 lorsque Blume a publié ce roman pour jeunes adultes révolutionnaire et piétinant les tabous : enfin, un livre qui parle franchement de sexe sans être primaire ou prurigineux, et de religion sans gronder ou être condescendant », a écrit Lev Grossman dans TIME. « Blume a transformé des millions de préadolescents en lecteurs. Elle y est parvenue en posant les bonnes questions – et en évitant les réponses faciles et patentes. » Elle a transformé des millions de préadolescents en lecteurs, et elle les a également aidés à se transformer en adolescents, un peu moins douloureusement qu’ils ne l’auraient fait autrement.
« Blume n’a pas été le premier écrivain à légitimer et à célébrer la vie intérieure des jeunes filles », a souligné Anna Holmes dans The New Yorker.
Fitzhugh, Beverly Cleary et Laura Ingalls Wilder ont toutes imprégné leurs protagonistes féminins du même genre de cran et d’autonomie, tout comme les écrivaines bien-aimées de Y.A. Lois Lowry et Lois Duncan, dont les livres les plus populaires, comme ceux de Blume, ont été publiés entre 1970 et 1985. Mais l’œuvre de Blume semble nettement plus influente que celle de ses prédécesseurs et de ses pairs, du moins en ce qui concerne la culture pop contemporaine. (Je soupçonne que cela a beaucoup à voir avec la manière directe dont Blume aborde des sujets difficiles, sans oublier son don pour les dialogues réalistes et sa compassion palpable pour ses personnages et ses lecteurs). Le scénariste oscarisé Diablo Cody, qui a écrit « Young Adult », le drame acclamé par la critique de l’année dernière sur un écrivain marginal, a publié une appréciation de Blume dans les pages d’Entertainment Weekly en 2008. Et le roman de Chuck Palahniuk de 2011, Damned, qui est centré sur la mort d’une protagoniste féminine de treize ans et sa descente en enfer, est inspiré des livres de Blume, jusque dans sa structure.
Ce n’est donc pas que ce soit un tel exploit littéraire – c’est que génération après génération a lu et aimé et s’est consolé avec ce livre. Il s’est profondément enfoncé dans notre conscience culturelle – sans même être un film. Aujourd’hui, après près de 50 ans, le livre est adapté au cinéma, ce qui a suscité une nouvelle vague de souvenirs et de remémorations. « C’est ce droit de passage pour les femmes et les filles », a déclaré la réalisatrice Kelly Fremon Craig à Deadline. « Il est rare que je croise une femme ou une fille qui ne l’a pas lu et chaque fois que j’en parle à une femme, elle se serre le cœur et laisse échapper ce souffle joyeux. Il y a quelque chose de si opportun et de si vrai, et je me souviens qu’à cet âge-là, ce livre m’a semblé être un radeau de sauvetage à un moment où je suis perdue, en quête et incertaine. Ce livre arrive et vous dit que vous n’êtes pas seule. Les femmes se souviennent de l’endroit où elles se trouvaient lorsqu’elles l’ont lu. Je ne peux pas penser à un autre livre dont on puisse dire ça. »
 Alex Comfort, Les joies du sexe (1972)
Alex Comfort, Les joies du sexe (1972)
De même que Les joies de la cuisine ont changé la vie et ont été omniprésentes dans les foyers américains dans les années 1930, les joies du sexe l’ont été dans les années 1970. Lors de sa publication en 1972, comme l’a dit Sarah Lyall, « le livre s’est imposé dans la conscience publique avec toute la subtilité d’un gigolo à une convention d’évêques ». Il a également connu une popularité stupéfiante, s’est installé sur les tables de chevet de toute l’Amérique et a passé 343 semaines sur la liste des meilleures ventes du New York Times ». Le sexe, c’est bien, nous rappelle le livre. C’est aimant, on se sent bien et c’est aussi amusant, même si vous ressemblez à l’homme poilu et que, comme lui, vous êtes farouchement opposé au déodorant. Écrit par le scientifique et médecin Alex Comfort, et finalement vendu à plus de 12 millions d’exemplaires dans le monde, le livre était une pièce séminale (désolé !) du paysage croissant de l’éducation sexuelle.
Un dauphin pour cet espace, bien sûr, est Our Bodies, Ourselves, un volume similaire assemblé par le Boston Women’s Health Book Collective. Comme l’a dit Ariel Levy dans le New Yorker :
Si Les joies du sexe ressemblaient aux joies de la cuisine – bien qu’à certains égards, il soit plus proche de Mastering the Art of French Cooking de Julia Child, avec sa forte voix d’auteur et son affection pour les préparations élaborées, auxquelles Comfort a donné des noms français comme pattes d’araignée, cuissade et feuille de rose – Our Bodies, Ourselves ressemblait au Moosewood Cookbook. Tout ce qu’il contenait était sain, éclairé, nourrissant.
Et légèrement dépourvu de graisse de bacon.
 Hunter S. Thompson, Fear and Loathing in Las Vegas (1972)
Hunter S. Thompson, Fear and Loathing in Las Vegas (1972)
L’extravagant road-trip de Thompson, marqué par la drogue, concerne les années 60, et non les années 70, mais c’est au cours de cette dernière décennie qu’il a été publié, et qu’il est devenu une sensation qui a fait parler d’elle. À ses débuts, le livre n’a pas fait l’objet d’excellentes critiques, mais les journaux n’ont pas tardé à s’y intéresser. Dans une critique du New York Times de 1972, Crawford Woods l’a qualifié de » de loin le meilleur livre encore écrit sur la décennie de la drogue passée » et, à propos de son importance littéraire, a écrit :
La moindre des réalisations de Thompson est de suggérer que, désormais, le Nouveau Journalisme est au monde ce que la Nouvelle Critique était au mot : séduisant, imposant et, finalement, inadéquat. La forme qui a atteint l’apothéose dans Les armées de la nuit arrive au bout de sa corde dans Fear and Loathing, une chronique de la dépendance et du démembrement si vicieuse qu’il faut beaucoup de résistance pour sentir que le but de l’auteur est plus moralisateur que sadique. Il se déplace dans un pays où seuls quelques survivants grincheux – Jonathan Swift pour ne citer qu’eux – sont allés auparavant. Et il se déplace avec l’intégrité froide d’un artiste indifférent à sa réception.
Maintenant, bien sûr, c’est un classique de la littérature de la contre-culture et l’exemple le plus célèbre du journalisme Gonzo de Thompson (bien qu’il le considère comme un exemple raté) et a envoyé plus d’un jeune homme enthousiaste à Vegas, on imagine.
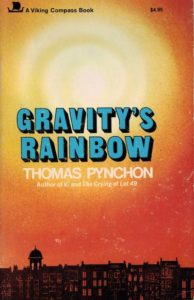 Thomas Pynchon, Gravity’s Rainbow (1973)
Thomas Pynchon, Gravity’s Rainbow (1973)
Bien que tout le monde ne l’aime pas, le roman mammouth de Pynchon sur la Seconde Guerre mondiale est certainement un candidat pour notre Grand roman américain et a influencé à son tour une flopée d’autres Grands écrivains américains, dont George Saunders, qui a écrit :
Je ne pense pas que quelqu’un ait été plus près que Thomas Pynchon de convoquer l’audace, la folie et l’étendue réelles de l’esprit américain, telles qu’elles se reflètent dans le paysage américain. J’ai lu Pynchon dans le désordre, en commençant par Vineland, et je me souviens encore du choc de plaisir que j’ai eu en voyant enfin l’Amérique que je connaissais – des magasins étranges et des boulevards, construits sur d’anciens magasins étranges et d’anciens boulevards, tous disposés là dans des vallées et des forêts sans issue, entassés sur des cimetières indiens, peuplés de cinglés, d’arnaqueurs et de puristes moraux – réellement présente dans un roman, et présente non seulement dans la substance mais dans une structure et un langage qui utilisaient et évoquaient à la fois la complexité indisciplinée et musclée du monde lui-même.
Dans Pynchon, tout est permis – si c’est dans le monde, ça peut aller dans le livre. Pour moi, il y a quelque chose de bouddhiste dans cette approche, qui semble dire que puisque le monde est capable de produire une infinité de formes, le roman doit être capable d’accueillir un nombre infini de formes. Toutes les préoccupations esthétiques (le style, la forme, la structure) répondent à ce but : laisser dans le monde.
C’est pourquoi Pynchon est notre plus grand écrivain, l’étalon-or de ce mot surutilisé d’inclusivité : Aucun dogme, aucune règle esthétique ou mode littéraire n’est autorisé à préfiltrer les belles données qui affluent. Tout est inclus. Aucune inclinaison de l’esprit n’est trop petite, trop grande ou trop effrayante. Le résultat est une folie magnifique, qui fait ce que la grande littérature a toujours fait – nous rappeler qu’il y a un monde là-bas qui est plus grand que nous et digne de notre plus grande humilité et de notre attention.
Gravity’s Rainbow a remporté le U.S. 1974 National Book Award for Fiction (ou le National Book Award pour la fiction). National Book Award for Fiction (ou techniquement, l’a partagé avec A Crown of Feathers and Other Stories d’Isaac Bashevis Singer – est-ce la raison pour laquelle il y avait un streaker à la cérémonie ?), et a été sélectionné à l’unanimité pour le Pulitzer par le jury de fiction – Elizabeth Hardwick, Alfred Kazin et Benjamin DeMott – mais le conseil d’administration du Pulitzer l’a refusé car il était » illisible « , » turgescent « , » trop écrit » et » obscène « , et aucun prix n’a été décerné cette année-là. Dans une critique parue en 1973 dans le New York Times, intitulée « L’un des romans les plus longs, les plus difficiles et les plus ambitieux depuis des années », Richard Locke écrit :
Gravity’s Rainbow est plus long, plus sombre et plus difficile que ses deux premiers livres ; en fait, c’est le roman le plus long, le plus difficile et le plus ambitieux à paraître ici depuis Ada de Nabokov, il y a quatre ans ; ses ressources techniques et verbales rappellent Melville et Faulkner. En s’immergeant dans « l’élément destructeur » et en explorant la paranoïa, l’entropie et l’amour de la mort comme forces primaires de l’histoire de notre temps, Pynchon établit sa continuité imaginative avec les grands écrivains modernistes des premières années de ce siècle. Gravity’s Rainbow est d’une densité bon enfant, compulsivement élaboré, stupide, obscène, drôle, tragique, pastoral, historique, philosophique, poétique, grinçant, ennuyeux, inspiré, horrible, froid, gonflé, échoué et dynamité.
« Parmi les écrivains américains de la seconde moitié du XXe siècle, Pynchon est le candidat incontesté à la grandeur littéraire durable », a écrit Richard Lacayo dans TIME. « Ce livre en est la raison. »
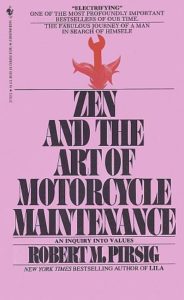 Robert Pirsig, Zen et l’art de l’entretien de la moto (1974)
Robert Pirsig, Zen et l’art de l’entretien de la moto (1974)
L' »autobiographie romanesque » de Pirsig a été rejetée 121 fois avant d’être finalement acceptée pour publication, mais son éditeur James Landis savait reconnaître une bonne chose quand il la voyait. « Le livre est brillant au-delà de toute croyance », a-t-il écrit avant la publication du livre. « Il s’agit probablement d’une œuvre de génie qui atteindra, j’en suis sûr, le statut de classique. » Que quelqu’un donne à ce type un support de voyance, car le livre a connu un succès immédiat et durable. Zen and the Art of Motorcycle Maintenance s’est vendu à un million d’exemplaires la première année, et a continué à se vendre au cours des 40 années qui ont suivi. « Les romans de l’esprit du temps ont tendance à tomber dans l’une des trois catégories suivantes, qui n’ont rien à voir avec la qualité de l’œuvre elle-même », a écrit Nathaniel Rich.
Dans la première catégorie, on trouve les livres nostalgiques d’un passé plus simple et romancé ; Centenaire de James A. Michener, le roman le plus vendu de 1974, en est un exemple. La deuxième catégorie est constituée de livres qui capturent involontairement l’esprit de leur époque, un exploit accompli au début des années 60 par Vol au-dessus d’un nid de coucou et Le Groupe. Les romans prospectifs, qui laissent entrevoir l’avenir tout en faisant écho aux angoisses du présent – 1984, Neuromancer, White Noise – constituent la troisième catégorie. Zen et l’art d’entretenir sa moto, de Robert M. Pirsig, réussit l’exploit remarquable d’être à cheval sur ces trois catégories, réalisant ainsi une triple couronne inhabituelle. C’est un roman nostalgique, à l’ancienne, qui reflète néanmoins le malaise de son époque et préfigure notre propre ère technophile. Le tour du chapeau de Pirsig a beaucoup à voir avec l’incroyable succès commercial du roman.
« Il y a une chose comme un zeitgeist, et je crois que le livre était populaire parce qu’il y avait beaucoup de gens qui voulaient une réconciliation – même s’ils ne savaient pas ce qu’ils cherchaient », a déclaré le sociologue Todd Gitlin au New York Times. « Pirsig a fourni une sorte d’atterrissage en douceur de la stratosphère euphorique de la fin des années 60 vers le monde réel de la vie adulte. »
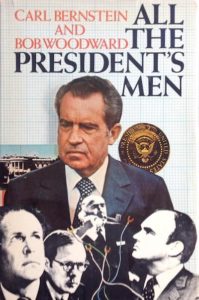 Carl Bernstein et Bob Woodward, Tous les hommes du président (1974)
Carl Bernstein et Bob Woodward, Tous les hommes du président (1974)
« C’est l’ouvrage qui a fait tomber une présidence et lancé un millier de carrières de journalistes », comme l’a dit Alex Altman dans TIME. « Il reste un témoignage du pouvoir du reportage en cuir de chaussure – et est peut-être le morceau de journalisme le plus influent de l’histoire. » Oui, Woodward et Bernstein ont changé le pays avec ce livre – ou, pour être précis, d’abord avec leur reportage sur Nixon et le scandale du Watergate, ensuite avec ce livre, et enfin avec l’adaptation cinématographique, parce que Robert Redford rend tout plus facile. C’était, bien sûr, dans les années 70, quand le disco était à la mode, que nous avions tous des tapis à poils longs et que le Congrès se souciait de savoir si le président américain était ou non un menteur corrompu. En effet, Nixon a démissionné quelques mois seulement après la publication du livre. Des jours meilleurs, mes amis.
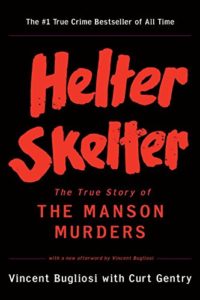 Vincent Bugliosi, Helter Skelter (1974)
Vincent Bugliosi, Helter Skelter (1974)
Peu d’événements ont capté la conscience publique comme les meurtres de Manson et le procès qui a suivi. Même 45 ans après la condamnation de Charles Manson en 1971, si vous écrivez un roman basé sur lui, il a toutes les chances de devenir un best-seller. Le récit des crimes, du procès et de la condamnation par le procureur Vincent Bugliosi s’est vendu à plus de sept millions d’exemplaires et est (ou du moins était au moment de la mort de Bugliosi en 2015) le livre sur le crime véritable le plus vendu jamais publié. Dans une critique parue en 1974 dans le LA Times, Robert Kirsch l’a décrit ainsi :
Bien qu’il s’agisse essentiellement d’un point de vue du procureur sur cette affaire complexe, le livre tente quelque chose de plus : le récit le plus complet des meurtres, de l’enquête, des procès et des suites jamais écrit. Une partie de ce récit est le fruit d’une observation directe et de mois d’immersion dans les profondeurs de l’affaire – y compris la nature paradoxale des contacts de l’auteur avec Manson, qui a souvent manifesté son respect réticent pour Bugliosi en tant qu’adversaire en conversant avec le procureur. C’est une mesure de l’importance de ce dernier aux yeux de Manson que Bugliosi ait été placé en haut de la liste des morts de la Famille.
La façon dont cette critique se termine est révélatrice. « Nous ne pouvons pas nous permettre d’ignorer les meurtres de Tate-La Bianca », écrit Kirsh. « Trop de choses se sont produites depuis pour montrer la menace que représente pour la société la violence occasionnelle et apparemment insensée, des meurtres de Santa Crux et des massacres de Houston aux crimes de l’Armée de libération symbionaise. Accepter ces actes comme de simples symptômes du malaise de l’époque, c’est renoncer à l’obligation qu’a la civilisation d’aborder rationnellement même les événements les plus irrationnels et les plus effrayants. » Le volume de Bugliosi était l’une de ces adresses rationnelles-dans une mer d’hystériques.
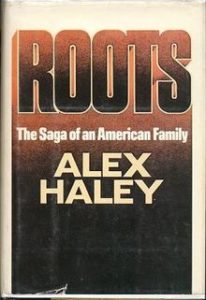 Alex Haley, Roots (1976)
Alex Haley, Roots (1976)
Je fais une entorse à la règle de ne pas répéter les auteurs pour Alex Haley, car The Autobiography of Malcolm X, bien que raconté et rapporté par lui, n’était pas vraiment son histoire. Roots : The Saga of an American Family était basé sur l’histoire de sa propre famille (bien que l’authenticité du livre et même l’originalité de l’œuvre de Haley aient été remises en question), et il est rapidement devenu une sensation culturelle. Il s’est vendu à plus de six millions d’exemplaires en 1977 et a figuré sur la liste des best-sellers du New York Times pendant quarante-six semaines, dont vingt-deux à la première place. Bien que Saul Bellow ait remporté le prix Pultizer de la fiction en 1976, Haley a reçu une citation spéciale l’année suivante – qui, soit dit en passant, a été l’année où la mini-série a été diffusée sur les télévisions américaines et a véritablement propulsé ce livre dans le grand public. Haley était une immense célébrité ; l’historien Willie Lee Rose l’a qualifié d' »événement culturel le plus stupéfiant du bicentenaire américain ». Selon la notice nécrologique de Haley parue en 1992 dans le New York Times, le livre et la mini-série « ont suscité un intérêt pour la généalogie chez les Américains d’origines ethniques diverses » et, à cette époque du moins, l’émission figurait toujours « parmi les 100 programmes les plus populaires ». Selon Nielsen Media Research, ses huit épisodes ont atteint des audiences moyennes allant de 28,8 millions de foyers à 36,3 millions de foyers ». Dans une interview de 1992, Haley a déclaré : « À ce jour, les gens, en particulier les Afro-Américains mais aussi les Blancs, vont juste totalement, de manière inattendue, s’approcher et ne pas dire un mot, juste s’approcher et vous serrer dans leurs bras et ensuite dire « Merci ». »
 Stephen King, The Shining (1977)
Stephen King, The Shining (1977)
Stephen King a eu autant (ou plus) d’influence sur le paysage littéraire américain que n’importe quel autre auteur ; The Shining a été sa première grande percée. Oui, ses deux premiers romans, Carrie (1974) et Salem’s Lot (1975) avaient été de gros vendeurs en livre de poche, mais The Shining a été le premier roman de King à devenir un best-seller en livre relié. Autrement dit, les gens étaient prêts à payer le prix fort pour l’acquérir. « Je pense que mon public s’est déplacé », a théorisé King en 1981. « Beaucoup de gens ont commencé à lire mes livres quand ils avaient 15 ans et maintenant ils sont plus âgés et peuvent se permettre d’acheter une couverture rigide ». Quoi qu’il en soit, The Shining est devenu l’une des œuvres les plus emblématiques de King, en partie à cause de l’adaptation de Stanley Kubrick, qu’il détestait de façon célèbre. Dans une introduction au livre datant de 2001, King le décrit comme son « roman à la croisée des chemins » et suggère que son succès repose sur sa décision « d’aller plus loin – d’admettre l’amour de Jack pour son père en dépit (peut-être même à cause) de la nature imprévisible et souvent brutale de ce dernier ». Le résultat final a à la fois satisfait et transcendé les règles habituelles du genre – et bien qu’il ait toujours eu sa part de mauvaises critiques, on ne peut nier que le peuple aime son King.
Voir aussi :
Toni Morrison, The Bluest Eye (1970), Stanislaw Lem, Solaris (première traduction anglaise, 1970), Dee Brown, Bury My Heart at Wounded Knee (1970), Kate Millet, Sexual Politics (1970), James Dickey, Deliverance (1970), Joan Didion, Play it As It Lays (1970), The Complete Stories of Flannery O’Connor (1971), Dr. Seuss, The Lorax (1971), Frederick Forsyth, The Day of the Jackal (1971), William Peter Blatty, The Exorcist (1971), Jane Goodall, In the Shadow of Man (1971), Boston Women’s Health Book Collective, Our Bodies, Ourselves (1971), John Berger, Ways of Seeing (1972), Harold Bloom, The Anxiety of Influence (1973), Richard Bach, Jonathan Livingston Seagull (1973), J. G. Ballard, Crash (1973). G. Ballard, Crash (1973), Toni Morrison, Sula (1973), Adrienne Rich, Diving Into the Wreck (1973), Italo Calvino, Invisible Cities (première traduction anglaise, 1974), Studs Terkel, Working (1974), Peter Benchley, Jaws (1974), Annie Dillard, Pilgrim at Tinker Creek (1974), Stephen King, Carrie (1974), Ursula K. Le Guin, The Dispossessed (1974), John Ashbery, Self-Portrait in a Convex Mirror (1975), E. L. Doctorow, Ragtime (1975), William Gaddis, J R (1975), Saul Bellow, Le cadeau de Humboldt (1975), Edward Abbey, The Monkey Wrench Gang (1975), Samuel R. Delany, Dhalgren (1975), Natalie Babbitt, Tuck Everlasting (1975), James Salter, Light Years (1975), Paul Theroux, The Great Railway Bazaar (1975), Renata Adler, Speedboat (1976), Raymond Carver, Will You Please Be Quiet, Please ? (1976), Marge Piercy, Woman on the Edge of Time (1976), Anne Rice, Interview with the Vampire (1976), Maxine Hong Kingston, The Woman Warrior (1976), Bruno Bettelheim, The Uses of Enchantment (1976), Philip K. Dick, A Scanner Darkly (1977), Toni Morrison, Song of Solomon (1977), Michael Herr, Dispatches (1977), Joan Didion, A Book of Common Prayer (1977), John Irving, The World According to Garp (1978), Iris Murdoch, The Sea, The Sea (1978), Hubert Selby Jr, Requiem for a Dream (1978), Edward Said, Orientalism (1978), Douglas Adams, The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy (1979), Octavia Butler, Kindred (1979), Elizabeth Hardwick, Sleepless Nights (1979), William Styron, Le choix de Sophie (1979), Angela Carter, La chambre sanglante (1979), Norman Mailer, Le chant du bourreau (1979), Cormac McCarthy, Suttree (1979)
.