
Le temps ne joue pas en faveur de Duane Oates. Son corps est lentement empoisonné.
Il y a trois ans, il a découvert que ses reins avaient commencé à s’arrêter. Aujourd’hui, la plupart du temps, cet homme de 56 ans passe des heures branché à un appareil de dialyse qui élimine l’excès de liquide et les déchets qui s’accumulent en lui.
Bien que les médecins parlent de dialyse comme d’un « traitement de remplacement du rein », il s’agit au mieux d’un palliatif. La machine ne fait que 15% du travail d’un rein normal. « Que se passe-t-il avec les 85% restants que je n’obtiens pas ? » demande Oates, assis dans un fauteuil médicalisé dans une clinique près de Washington DC. « Chaque jour où je suis sous dialyse, mon corps devient moins sain ».
Ce dont il a besoin, c’est d’un nouveau rein qui filtre son sang 24 heures sur 24. Comme le dit son médecin spécialiste Ashté Collins : « La thérapie optimale de remplacement du rein est une transplantation ».
Le problème est que les États-Unis, comme presque tous les pays, connaissent une pénurie permanente de donneurs. Oates est en assez bonne santé pour une greffe de rein, mais seulement 22 000 sont réalisées aux États-Unis chaque année. Il y a 100 000 personnes en attente.
La pénurie est particulièrement aiguë dans les grandes villes, où l’attente peut durer jusqu’à 10 ans. Pendant ce temps, alors que les toxines continuent de s’accumuler dans le corps des patients, ils sont confrontés à des risques croissants de maladies cardiaques et d’accidents vasculaires cérébraux.
« La plupart des personnes qui ont besoin d’une greffe de rein ne la recevront malheureusement jamais parce qu’elles meurent alors qu’elles sont sur la liste d’attente », explique le Dr Keith Melancon, qui dirige l’unité de transplantation rénale de l’hôpital universitaire George Washington.
L’ampleur de la crise aux États-Unis – qui dépensent plus pour les soins rénaux et effectuent plus de transplantations que toute autre nation – est saisissante. La maladie rénale touche un adulte sur sept.
Crise rénale américaine. ,,, Source : Source : CDC, Image : Deux chirurgiens transplantant un rein
En raison de différences génétiques, les Afro-Américains sont trois fois plus susceptibles que les Blancs de développer une insuffisance complète. Oates en est un exemple – son rein a cessé de fonctionner à la suite d’une « glomérulosclérose segmentaire focale », une maladie qui touche de manière disproportionnée les personnes noires.
Même pour quelqu’un qui est encore relativement en bonne santé comme Oates, la dialyse porte un lourd tribut. Il travaillait auparavant comme chef de projet dans le secteur de la construction. Bien qu’il essaie de rester actif, le fait de devoir filtrer son sang quatre matins par semaine l’empêche de conserver un emploi.
« Lorsque vous êtes frappé pour la première fois, vous êtes un peu dans un endroit sombre. Mais vous devez vous battre et ne pas vous laisser envahir par la maladie ».
C’est un combat que beaucoup de patients perdent. « S’ennuyer est le baiser de la mort », dit Towanda Maker, la formidable directrice de la clinique. « Cela mène à la dépression, qui est la maladie mentale numéro un chez les patients dialysés. »
La dialyse n’a pas besoin d’être effectuée dans une clinique. De nombreux patients reçoivent des machines qui leur permettent d’effectuer une dialyse plus efficace dans le confort de leur foyer. Mais malgré les encouragements amicaux de Mme Maker, Oates ne se sent pas tout à fait prêt pour l’autodialyse, qui nécessite de planter d’épaisses aiguilles dans ses veines.
La dialyse, sous quelque forme que ce soit, ne peut pas faire grand-chose. Plutôt que de languir pendant des années sur la liste des transplantations, Oates a décidé d’agir.

Il a rejoint un programme parrainé par la National Kidney Foundation, « Big Ask, Big Give », qui fournit des conseils sur la façon de demander aux gens s’ils ont un rein en trop – après tout, nous en avons tous deux mais n’en avons besoin que d’un seul.
Certains des patients de Mme Maker ont conçu leurs propres stratégies. L’un d’eux a lancé avec succès un appel sur Facebook. Certains ont fait fabriquer des T-shirts « I need a kidney ». avec leurs coordonnées au dos. « Les gens sont devenus très créatifs », dit-elle.
Un autre moyen innovant d’augmenter vos chances de trouver un donneur est l’échange de reins – où un donneur et un receveur qui ne sont pas compatibles peuvent trouver une autre paire non compatible pour un bénéfice mutuel.
Ces initiatives peuvent aider les individus, mais elles ne résoudront pas le problème sous-jacent : il n’y a pas assez de reins disponibles pour la transplantation.
De nombreux pays, notamment en Europe continentale, ont essayé de stimuler l’offre de donneurs décédés par une approche de « consentement présumé ». Un tel système, également connu sous le nom de « opt out », place automatiquement les personnes sur un registre national de donneurs à moins qu’elles ne choisissent de ne pas l’être.
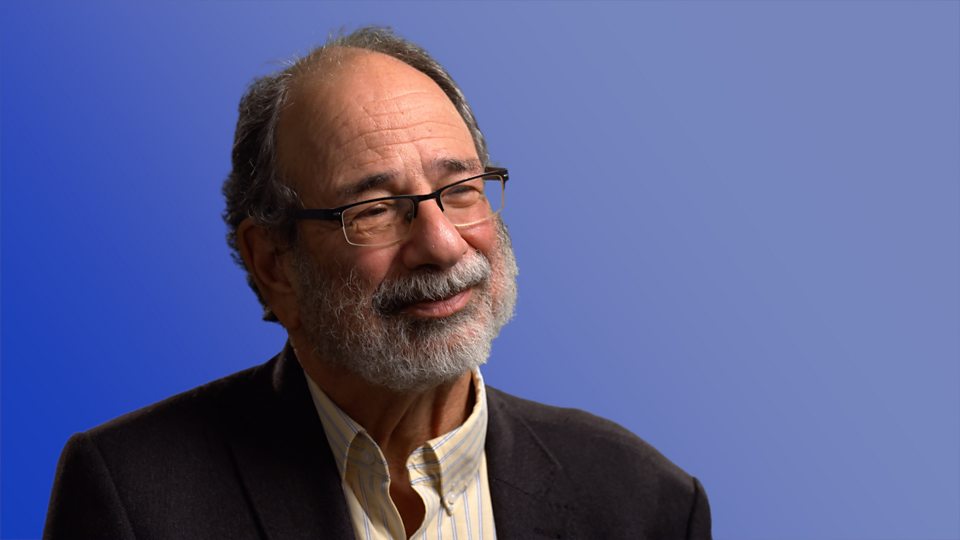
Tous les États américains, en revanche, ont des lois « opt-in ». Le passage à l' »opt-out » ferait-il une grande différence ? Des études internationales suggèrent que non. L’Espagne, qui dispose d’un consentement présumé, n’est que légèrement en avance sur les États-Unis pour le nombre de transplantations par rapport à sa population ; la France et la Belgique, qui disposent d’une législation similaire, ont moins de transplantations.
Le Pays de Galles est actuellement la seule partie du Royaume-Uni avec un système de consentement présumé – l’Angleterre devrait suivre le mouvement plus tard cette année. Mais le Pays de Galles n’a pas vu une augmentation des dons d’organes après avoir changé sa loi en 2015.
- Pas d’augmentation des donneurs d’organes depuis le changement de loi
Un système similaire aux États-Unis pourrait aider seulement un peu, estime le Dr Melancon de l’hôpital universitaire George Washington. « Nous serions toujours en deçà si nous avions un consentement présumé », dit-il.
Selon Joseph Vassalotti, médecin-chef de la National Kidney Foundation, une façon de tirer le meilleur parti des donneurs décédés est d’améliorer le « taux de rejet ». Environ un cinquième des reins qu’ils fournissent sont jugés malsains et jetés.
Si les États-Unis suivaient la politique française et acceptaient les reins des patients âgés et des diabétiques, par exemple, il pourrait y avoir 17 000 reins supplémentaires disponibles pour la transplantation, dit le Dr Vassalotti.

Il existe cependant un large consensus sur le fait que le moyen le plus sûr d’atténuer sensiblement la pénurie de reins est d’augmenter le nombre de donneurs vivants. Mais il y a un désaccord féroce sur la façon d’y parvenir.
Un contributeur de premier plan au débat est Sally Satel. Chercheuse à l’American Enterprise Institute (AEI), un groupe de réflexion de Washington, elle a un intérêt personnel intense pour le sujet. En 2004, ses reins ont commencé à lâcher. Elle voulait absolument éviter la dialyse, mais étant fille unique et sans famille proche, elle ne savait pas comment trouver un donneur. Sa quête a consisté à mentionner principalement son état à son entourage.
« Je n’ai jamais demandé à personne de manière directe », se souvient Satel, assise dans le foyer feutré de l’AEI. « J’ai juste abordé le sujet. Je ne sais pas à quoi je pensais. J’ai juste supposé que ça arriverait. »
Plusieurs amis ont offert leur rein mais se sont retirés – à deux reprises après que leurs conjoints aient menacé de divorcer si les dons avaient lieu. En 2006, la santé de Mme Satel se détériore rapidement. Elle était à quelques semaines de la dialyse lorsque le miracle espéré s’est produit.
Virginia Postrel, un écrivain politique, a entendu parler de la situation difficile de Satel alors qu’elle faisait la conversation à une fête. Mme Postrel est rentrée chez elle, a fait des recherches sur le don de reins et a envoyé un courriel à Mme Satel pour lui dire qu’elle pouvait avoir un des siens.

Le message, intitulé « une offre sérieuse », a été immédiatement suivi d’un deuxième courriel d’une seule ligne qui disait : « Je ne ferai pas marche arrière ». Quatorze ans après être devenue le donneur de rein le plus célèbre d’Amérique, Mme Postrel dément toute suggestion selon laquelle sa décision était admirable.
« J’appelle toujours cela la bonne action la plus facile du monde », dit-elle. « Vous vous présentez, vous êtes anesthésié, vous vous réveillez. Il y a très peu de choses à faire par la suite. Les gens font des choses plus extraordinaires tous les jours, en termes de prise en charge de parents vieillissants. »
L’intensité de sa voix suggère que ce n’est pas de la fausse modestie. « Le récit journalistique traditionnel de ‘Oh le héros bla bla bla’ – je pense que cela rend les gens moins susceptibles de faire des dons. Il faut normaliser la situation. »
Le rein de Satel Postrel a duré 10 ans. Lorsque son système immunitaire l’a rejeté, à 60 ans, elle avait trouvé un autre donneur. Satel en est maintenant à son troisième rein droit et se sent bien.
Elle a eu de la chance – deux fois. Mais en tant qu’experte en politique, l’expérience a laissé Satel profondément insatisfaite d’un système qui repose sur la chance et la gentillesse d’inconnus. La raison pour laquelle si peu de reins sont disponibles pour la transplantation, soutient-elle, est qu’en vertu de la loi nationale sur la transplantation d’organes de 1984, payer pour des organes est illégal.
Les États-Unis ne sont pas exceptionnels – l’Iran est le seul pays qui autorise de telles transactions et il ne connaît pas de pénurie de reins. Satel ne préconise pas un marché des parties du corps à l’iranienne. Mais elle pense que des incitations financières bien conçues peuvent élargir le bassin de donneurs tout en répondant aux préoccupations liées au paiement en espèces des organes.
« Ils ont peur que les gens se précipitent pour le faire sans savoir ce qu’ils font parce que les récompenses sont si attrayantes », dit-elle. « Il y a un million de façons d’aborder cela. »

Un document de 2017 coécrit par Satel décrit les garanties telles que la période d’attente intégrée et la compensation retardée. Un paiement de, disons, 50 000 $ pourrait prendre la forme d’un crédit d’impôt étalé sur 10 ans, de bons scolaires ou d’un autre avantage gouvernemental à long terme.
Ses idées rencontrent une résistance farouche de la part de ceux qui veulent maintenir les dons sur une base purement caritative. Une objection commune, décrite dans cet article du Los Angeles Times, est que les incitations financières évinceraient les dons altruistes.
Satel rejette cette notion comme illogique et fait valoir que les incitations financières permettraient non seulement d’améliorer la durée et la qualité de vie des patients atteints de maladies rénales, mais aussi d’économiser une énorme quantité d’argent. Un demi-million d’Américains sont sous dialyse et les soins de chacun d’entre eux coûtent 100 000 dollars (77 000 livres) par an. Medicare, le programme fédéral américain qui prend en charge la majeure partie de la facture, y consacre 7 % de son budget, alors que les patients dialysés ne représentent que 1 % de ses bénéficiaires.
Si l’on ajoute les prestations d’invalidité et les impôts abandonnés, les coûts de la dialyse éclipsent ceux de la transplantation et des soins post-transplantation.

Des études ont tenté de quantifier les avantages que la société américaine tirerait de différents niveaux de compensation. Un article a constaté que le fait d’offrir 45 000 dollars pour chaque rein donné entraînerait un gain net de 46 milliards de dollars pour l’Amérique dans son ensemble, grâce à la réduction des coûts médicaux et à la vie professionnelle plus normale des patients.
Les sondages ont suggéré qu’une majorité d’électeurs américains seraient favorables à des paiements non monétaires pour les organes si cela permet de sauver des vies. Mais ceux qui veulent maintenir les dons sur une base purement caritative voient d’un mauvais œil de tels calculs et s’en tiennent aux principes.
La National Kidney Foundation (NKF) – une voix puissante dans l’élaboration des politiques publiques dans ce domaine – s’oppose à toute révision radicale de l’interdiction de 1984. « Toute tentative d’attribuer une valeur monétaire au corps humain », dit-elle, risque de « dévaluer la vie humaine même que nous cherchons à sauver ».

De nombreux contributeurs à la bioéthique – l’étude des droits et des torts de la recherche médicale – considèrent également les incitations financières comme potentiellement exploitantes. David Gortler, ancien fonctionnaire de la Food and Drug Administration et ancien membre du Centre de bioéthique de l’université de Yale, craint que les gens ne prennent des décisions imprudentes parce qu’ils ont besoin d’argent.
« Je n’ai aucune confiance dans le fait que les gens vont dépenser plus intelligemment qu’un adolescent avec un chèque en blanc », dit-il.
Les réticences profondes à l’égard de la rémunération des donneurs signifient que la loi de 1984 ne sera pas confrontée à un défi frontal de sitôt.
Un certain nombre d’États américains accordent désormais des allègements fiscaux d’une valeur maximale de 10 000 dollars pour couvrir les frais liés au don d’organes – tels que les frais de déplacement, d’hébergement et les pertes de salaire. Mais ces mesures pourraient avoir un impact limité, car la recherche suggère que la valeur totale des facteurs de dissuasion auxquels sont confrontés les donneurs est beaucoup plus élevée.
Il y a eu des démarches fédérales pour retoucher la loi de 1984, mais il est peu probable qu’elles aillent très loin non plus. Un projet de loi visant à étudier l’effet de la compensation non monétaire sur l’offre d’organes est bloqué au Congrès depuis 2016.
Les choses pourraient changer en temps voulu, mais pas assez vite pour Duane Oates. Il fonde ses espoirs de trouver un rein non pas sur les politiciens, mais sur la force intérieure qu’il tire de sa famille et de son dieu. « Vous pouvez laisser les choses vous tirer vers le bas et aller ramper sous un rocher, ou vous pouvez faire en sorte que quelque chose d’autre se produise pour vous », dit-il.
« Le vent sous mon aile est ma fille et ma femme. Quand je semble déprimer, je pense à elles et je m’en sors. Nous sommes forts sur la croyance de la foi. »